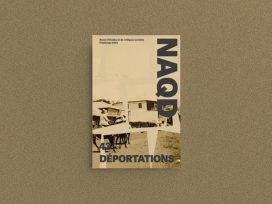EN un mois et trois discours (au Vatican, en Arabie Saoudite et à Paris), Nicolas Sarkozy semble avoir ouvert un nouveau chantier : celui des rapports entre la République et les religions. Passons sur l’opportunité ou l’opportunisme de la démarche. Devant une partie de la gauche et aussi quelques élus de droite ancrés dans une tradition laïque intransigeante, M. Sarkozy agite un chiffon rouge dont l’effet est le plus classique qui soit en France : mobiliser dans la dénonciation la gauche (et surtout, en elle, le vieil anticléricalisme dont la cible principale reste l’Église catholique), les nouveaux adversaires de la religion rassemblés surtout par les craintes autour de l’islam, le journalisme ignare qui lit les résumés de dépêches et non les discours en entier, une frange de républicains motivés par l’idée que 1905 est une loi intangible et que rien d’important n’a changé dans la donne religieuse depuis un siècle.
Un nouveau chantier : reconsidérer les rapports entre la religion et la République
Les contextes romain, saoudien, parisien ne sont assurément pas les mêmes, mais la teneur des discours a été étonnamment proche. À Rome, le 13 décembre, l’occasion de sa visite était sa nomination comme chanoine de la basilique de Saint-Jean-de-Latran ; il faut, pour lire l’événement, effacer la part de folklore (la réception du titre de ” chanoine “), le cortège burlesque de ses invités et la désinvolture dont il s’est fait une spécialité. À Riyad, le 14 janvier, même ceux qui tiennent compte des réalités diplomatiques ont pu trouver qu’il en avait fait un peu trop en faveur du ” Dieu commun ” des mono- théismes devant l’Assemblée nationale de l’État wahhabite (non élue) ; cependant, à bien le lire, ce discours constitue une critique très habile de l’islam défendu et répandu par la dynastie saoudienne. Enfin à Paris, le 17 janvier, sans doute pour calmer le jeu, il a fait l’éloge de la laïcité devant les autorités religieuses venues lui présenter leurs v¦ux, tout en affirmant que ” la reconnaissance du senti- ment religieux comme une expression de la liberté de conscience et la reconnaissance du fait religieux comme un fait de civilisation font partie, au même titre que la reconnaissance de l’héritage des Lumières, de notre pacte républicain et de notre identité “.
Pour une ” laïcité positive “
Trois thèmes se mêlent dans le discours présidentiel (je m’en tiens dans ce qui suit surtout à celui de Rome). D’un côté, tout en ne cessant de rappeler son respect pour toutes les convictions, toutes les croyances, toutes les visions du monde – ” athées, francs-maçons, rationalistes “, ” ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas “, pour reprendre la banalité consacrée – , le président dit et répète une conviction : il existe un apport propre et universel du religieux à la société et à l’individu : la foi et l’espérance, la foi qui donne une espérance et qui suscite une action éthique, un engagement digne d’estime et utile à la cité humaine. L’universalité de cette foi et de cette espérance est exprimée de façon assez ambiguë pour donner prise aux protestations des athées ou des sans-religion : ” Le besoin pro- fond des hommes et des femmes de trouver un sens à l’existence ” serait commun aux croyants et aux incroyants ; en toutes les civilisations et à toute époque, on relève ” l’aspiration profonde des hommes et des femmes à une dimension qui les dépasse “. Ce ” fait ” dépasse les clivages entre croyants et non-croyants. Dans le même temps, en appelant constamment au respect de tous, en soulignant la valeur de la laïcité (une ” nécessité ” et une ” chance “), N. Sarkozy donne tort à qui verrait dans ces interventions une remise en cause du pluralisme des croyances et de la liberté religieuse : en particulier, ceux qui ne croient pas ne doivent en aucun cas subir l’intolérance ou le prosélytisme religieux.
La deuxième insistance porte sur les racines chrétiennes de l’Europe et de la France, qu’il n’est pas au pouvoir de quiconque de dénier ou de couper. Il faut défendre les ” deux bouts de la chaîne ” : les racines chrétiennes et la laïcité, celle qui doit devenir une laïcité positive, celle qui tout en veillant aux libertés de penser, de croire et de ne pas croire, ” ne considère pas les religions comme un danger “. Comme on le sait, un adjectif (” ouverte “, ” positive “) ajouté au mot ” laïcité ” a le don de mettre en émoi ou en furie des tenants de la laïcité tout court (” sans épithète ” comme disait Jules Ferry à propos de la morale), qui estiment la notion en elle-même autosuffisante, pour ne pas dire transcendante, céleste peut-être, comme la Jérusalem du même nom (ils devraient pourtant se demander pourquoi ceux qui ne font pas partie des cercles laïques militants éprouvent le besoin de qualifier la laïcité, dite française, avec des attributs positifs). À vrai dire, l’idée de laïcité positive est moins en cause, à mon avis, que l’éloge de la religion en général, et de l’Église catholique en particulier. Un éloge de l’Église par un président de la République ? De quoi donner de l’urticaire au camp laïque, comme si on lui enlevait quelque chose ou comme si la laïcité était aussitôt menacée… Mais n’est-ce pas aussi le signe de sa fragilisation et de sa fébrilité ?
La troisième inflexion – la plus importante, mais la moins soulignée dans les réactions – renvoie à la nécessité de nouveaux rapports entre la République laïque et la religion, dans le cadre des grands équilibres de 1905. En particulier, ” il s’agit de rechercher le dia- logue avec les grandes religions de France et d’avoir pour principe de faciliter la vie quotidienne des grands courants spirituels plutôt que de chercher à la leur compliquer “. La République a besoin de ” toutes les intelligences, de toutes les spiritualités qui existent dans notre pays “. Autrement dit, quelle place, quels droits pour les cultes – le catholique d’abord à cause de la tradition française, mais aussi les autres – dans la République laïque ?
Des considérations diverses, certaines quelque peu ” baroques “, émaillent par ailleurs le discours du président. Il salue (à juste titre) le rôle des théologiens, des religieux, de l’Église de France dans le rayonnement français à l’étranger ; il trouve anormal que la République ne reconnaisse pas le caractère culturel de l’action caritative, les diplômes universitaires délivrés dans l’enseignement supérieur catholique, les diplômes de théologie et les études supérieures des ministres du culte en général. Louant ” les sacrifices que représente une vie tout entière consacrée au service de Dieu et des autres ” (” on n’est pas prêtre à moitié, mais dans toutes les dimensions de la vie “), M. Sarkozy croit pouvoir affirmer que ” dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence du bien et du mal, jamais l’instituteur ne pourra remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en rapproche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie “.
Je ne sais s’il faut accorder beaucoup d’importance à ces réflexions disparates. On pourrait le chicaner sur la dernière par exemple, pour toutes sortes de raisons, dont l’une serait la disparition annoncée des prêtres en France (ainsi qu’en Europe et dans tous les pays développés dits ” postmodernes “) peut-être précisément à cause du ” sacrifice à vie ” de la vie entière. Sur le fond, Joël Roman a justement cri- tiqué la conception sarkoziste de la religion comme ” supplément d’âme dont les individus et nos sociétés ont besoin ” : la ” métaphysique du sarkozysme “, c’est que ” confrontés aux questions des fins dernières, la religion nous offre à la fois une explication et nous ras- sure : cela n’a pas grand-chose à voir avec une interrogation spirituelle “. J. Roman a évidemment raison : aucun théologien digne de ce nom ne donnerait aujourd’hui son aval à un tel simplisme. Mais cette critique intellectuelle méconnaît aussi que la grande majorité des croyants ou des vaguement croyants, ou des croyants sans appartenance, vivent ” la religion “, comme ils disent, exactement au niveau où se place N. Sarkozy : celui de l’utilité personnelle ou sociale.
Les bonnes raisons de M. Sarkozy
Contrairement à certaines impressions nées des premiers mois de sa présidence et déjà de sa campagne, N. Sarkozy semble vouloir ainsi renouer avec une action commencée au ministère de l’Intérieur. Il le fait à sa manière, sans prendre des gants, arrivant comme un chien dans un jeu de quilles pour bousculer habitudes et conformismes. Malgré les calculs probables, on se demande s’il mesure tous les enjeux. Il dit en apparence quelque chose d’assez simple : la loi de 1905 n’est pas mise en cause et n’a pas à l’être. Ses mérites doivent être sans cesse rappelés. Elle reste le socle. Mais les religions pourraient être mieux intégrées dans l’espace public et, vu l’état des lieux social et moral en particulier, la République gagnerait à cette coopération, à ce partenariat, à cette synergie. Elle a besoin de tout le monde. De toute évidence, Nicolas Sarkozy s’inscrit ainsi en faux contre la célébration en 2005 de l’anniversaire de 1905 (la loi de séparation), totalement consensuelle, d’un accord commun, entre l’État et l’Église catholique, mais célébration minimaliste et immobiliste, surtout inquiète du réveil possible des vieux démons. Alors que lui, Sarkozy, avait créé comme ministre de l’Intérieur, en 2003, le Conseil français du culte musulman (CFCM) – qu’on lui a assez reproché mais qui avait eu le mérite de faire bouger les choses.
Un présupposé se dégage de ce discours de rupture avec le statu quo : les grandes religions de la tradition ne représentent pas, ou ne sont plus, un danger, au contraire elles constituent un ” plus “. Et de ce point de vue, les discours du président sont incontestablement plus éclairés et à jour que ceux du Parti socialiste, emmuré dans ses certitudes laïques immuables, ses clichés et sa paresse intellectuelle. Nicolas Sarkozy évoque clairement l’affaiblissement quantitatif et qualitatif de l’Église catholique et des confessions religieuses en général – un fait confirmé par toute la sociologie religieuse mais obscurci dans l’opinion publique à cause des retombées médiatiques de la violence due à des extrémistes islamistes ou autres. En sens inverse – et le paradoxe est que les deux phénomènes sont liés – , la religion – la ” religion “, et non pas les Églises ou les confessions instituées ! – occupe encore ou de nouveau une place importante dans l’espace public, mais très différente de celle de 1905.
Ce que sous-estiment les tenants d’une laïcité intransigeante, c’est que le phénomène de la sécularisation érode et continue d’affaiblir non seulement les religions instituées ou ce qui en reste (quels que soient leurs liens ou leurs séparations institutionnels avec l’État), mais aussi et tout autant la laïcité céleste à laquelle ils adhèrent (comme les autres valeurs : la République, la Nation, la démocratie, les Lumières, la morale commune du Décalogue en Occident, etc.). À l’inverse, la sécularisation libère l’espace pour le religieux hors institution, individuel, pluriel, incontrôlé, bricolé, sauvage, sans histoire et sans culture, ou à un rapport plutôt libéral aux grandes religions établies (rapport libéral dont Sarkozy est lui-même un bel exemple). Le combat contre les grandes institutions religieuses, Églises ou autres, tape complètement à côté : plus elles s’affaiblissent, plus croît le religieux hors institutions, qui n’a que faire des séparations laïques. Le religieux n’est pas d’abord, aujourd’hui, un problème d’institution, mais de société émiettée et d’individus sans identité, et prêts à tout pour en avoir une. Dans ce contexte, ce ne sont pas ceux qui crient ” laïcité, laïcité ! ” en toute occasion, mais ceux qui considèrent avec lucidité les différences avec 1905, qui feront ¦uvre utile pour la République. La politique de l’autruche qui consiste à ignorer les nouveaux rapports de force entre le politique et le religieux, mais aussi à refuser les rapports de coopération possible, dans la société civile affaiblie, avec les grandes religions et à croire que l’incantation républicaine (c’est-à-dire finalement l’appel à l’État) suffit pour résoudre les problèmes, relève plus de la vanité française que d’une compréhension éclairée et dynamique de la laïcité. Voilà ce que M. Sarkozy et ceux qui le conseillent et écrivent ses discours ont mieux compris que d’autres.
Le tabou de la loi de 1905
Beaucoup de bruit pour rien ? À la sortie de la cérémonie des v¦ux à l’Élysée, les responsables catholiques et protestants allaient dans ce sens et minimisaient les propos présidentiels. Pourtant, en admet- tant que tout le monde est d’accord sur la loi de 1905, on peut imaginer plusieurs possibilités. Par exemple, l’offensive de M. Sarkozy serait une sorte de signal officiel, et rien de plus, pour mettre les montres à l’heure : celle de la fin du conflit des deux France, la catholique et la laïque, la religieuse et la républicaine. Il s’agirait d’ajuster le droit aux faits en insistant, sans sortir du cadre de la loi de séparation, sur ce qui unit. Cette ” normalisation ” pourrait se traduire simplement par quelques mesures concrètes en faveur de l’intégration des religions dans l’espace public. On irait plus loin, certes, avec la question qu’a posée avec insistance la Fédération protestante en 2005, notamment par la voix de son président de l’époque, Jean- Arnold de Clermont : ne faut-il pas ” toiletter ” la loi de 1905 à propos du statut des associations cultuelles (qui avantage actuellement l’Église catholique) ? Ne faut-il pas aussi revoir la question du financement des nouveaux édifices du culte (financement refusé aux constructions de mosquées en l’occurrence), ou inversement celui qui est apporté à l’entretien des édifices construits avant 1906 ? Dans les deux cas est posée la question de l’égalité des cultes dans l’État, ou de l’absence de discrimination entre eux.
Car la non-discrimination est aujourd’hui une question sensible. Officiellement, la laïcité française l’exclut en matière religieuse. La loi du 9 décembre 1905 porte en effet, à l’article 2, une formule essentielle : ” La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ” (mais, ajoute Émile Poulat, elle les ” connaît ” tous). Pourtant, même si la Libre Pensée et d’autres militantes associations laïques ont toujours veillé et veillent encore à l’application stricte de ce principe, la réalité est sensiblement différente : les grandes religions bénéficient de fait de toutes sortes d’avantages, qui sont des ” primes à l’ancienneté ” et qu’on appellerait des ” reconnaissances ” si le mot n’était tabou, dues à l’histoire et à la mémoire, à la place de ces religions dans la culture, au nombre de leurs adhérents : rencontres régulières quasi officialisées avec le président de la République et le Premier ministre, émissions de radio et de télévision réservées sur le service public, relations privilégiées de toutes sortes avec les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, fondations et associations bénéficiant de déductions fiscales sur les dons reçus, représentation dans des comités divers. Il n’est donc nul besoin, comme on le voit, d’avoir un régime de cultes reconnus pour accorder des avantages publics ou en bénéficier. Au fond, N. Sarkozy considère que le temps est venu d’étendre ou d’officialiser ces ” privilèges ” de l’histoire et du nombre, tout en restant dans la continuité d’une attitude pragmatique qui garde les principes de la laïcité en les ajustant à l’époque.
Mais l’État pourrait-il aussi, comme le président semble le souhaiter, améliorer le régime des facultés de philosophie et de théologie qui forment les ministres du culte, ” reconnaître ” les diplômes religieux délivrés par des instituts supérieurs privés ? Pourrait-il a fortiori (comme l’a fait en Angleterre Tony Blair) proposer un finance- ment public nouveau aux écoles privées confessionnelles, anciennes ou nouvelles ? C’est douteux : au nom de l’histoire et de la mémoire, il y a des lignes jaunes à ne pas franchir en France – du côté de l’enseignement en particulier. C’est pourtant dommage : comme le rappelle le débat récurrent sur la carte scolaire, ou le ” boum ” de la demande en direction de l’enseignement privé (d’origine catholique à 95 %), il vaudrait mieux se mettre au moins autour d’une table pour discuter plutôt que de figer hypocritement les positions.
Limites
L’évocation de M. Blair situe les limites d’une politique religieuse volontariste. Non pas du fait que le soutien ou les permissions accordées aux communautés minoritaires n’ont pu éviter à la Grande-Bretagne des attentats islamistes et des évolutions identitaires et communautaristes (femmes en burquas…) : ces derniers relèvent d’une actualité internationale n’épargnant aucun État. Mais une politique religieuse se heurte inévitablement au ” mur ” de la sécularisation avec ses nombreux ingrédients, aux libertés démocratiques et au pluralisme moderne (qui traverse aussi et affaiblit, on l’oublie trop, les grands groupes religieux). D’autre part et surtout, une religion consciente d’elle-même et digne de ce nom n’est pas, ne saurait être, le supplément d’âme d’une société sans âme, ou ” l’âme d’un monde sans c¦ur ” (comme dit Marx) ; elle ne fournit pas les repères ou les valeurs d’une société sans repères ni valeurs. Joël Roman a tout à fait raison sur ce point : quand elles sont instrumentalisées en ce sens, les religions perdent justement toute valeur. Et quand, à l’inverse, elles interviennent directement comme une force de pression collective contre des lois démocratiques qui leur déplaisent et des évolutions sociales qu’elles condamnent au nom d’un autre ordre de valeurs, elles se déconsidèrent et manifestent leur impuissance sociale et politique à l’âge de la sécularisation.
Pourtant, dans une démocratie pacifiée, une confession religieuse conforme à ses valeurs – de fraternité, de service, de gratuité, de civisme, de présence à autrui dans la difficulté – peut être utile à la société. Cela va de soi pour des croyants individuels qui militent dans la société civile et politique. Mais, comme cela a été souvent le cas en France depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, y compris depuis 1905, une religion peut aussi, comme telle, à travers des croyants qui se réclament d’elle, créer de nouvelles institutions pour répondre à de nouveaux besoins ou suppléer à des carences de l’État : la prétendue exclusivité républicaine en matière sociale relève plus du v¦u pieux que des réalités. La religion peut organiser des événements collectifs (des rassemblements) dans l’espace public qui méritent autant que d’autres ” animations ” le respect et l’aide de l’État. Contrairement à de nombreux discours et de nombreux efforts, aucune religion ne peut être confinée dans la sphère privée, encore moins à une période où le privé et le public comportent de nombreux passages. Il est au contraire légitime que les organisations de croyants, comme d’innombrables groupes et associations privées, aient une surface publique et reçoivent l’appui de l’État pour réaliser leurs objectifs d'” utilité publique “. Qu’est-ce qui est d'” utilité publique ” ? On pourrait assurément en discuter, mais l’extension donnée à cette notion depuis des années justifie certainement que les réalisations sociales, caritatives, intellectuelles, culturelles voire cultuelles des groupes religieux y soient incluses. Et donc implique que l’article 19 de la loi de 1905, qui interdit toute subvention à une association ” cultuelle ” quelle qu’elle soit, n’a plus beaucoup de sens.
On pourrait ajouter que même si leurs jugements éthiques ne plaisent pas actuellement dans des sociétés permissives (et très conformistes), il n’est pas sans intérêt d’entendre l’avis des religions. Il est vrai qu’en France notamment, beaucoup leur dénient même le droit de proposer des avis ou de protester. Les militants laïques qui iraient jusqu’à franchir le Rhin y rencontreraient pourtant un grand philosophe d’orientation rationaliste, qui ne voit pas la nécessité d’un fondement transcendant pour soutenir les valeurs politiques et morales, et n’en déclare pas moins aujourd’hui s’opposer
à l’Aufklärung bornée, non éclairée sur elle-même, qui conteste tout contenu rationnel à la religion […] Il faut admettre que la raison pratique perd sa propre raison d’être lorsqu’elle n’a plus la force d’éveiller et de maintenir éveillée dans des mentalités modernes une conscience de la solidarité partout mise en question dans le monde, une conscience de ce qui manque, de ce qui ” crie vers le ciel ” […] Des assertions religieuses peuvent apporter une contribution sensée pour éclairer des questions fondamentales controversées.
Les militants socialistes pourraient lire dans les propositions (octobre 2007) du Parti social-démocrate (SPD) pour rénover le programme de Bad-Godesberg (1959), ceci :
Pour nous, l’action des Églises, des communautés religieuses et des communautés basées sur une vision du monde, est irremplaçable, en particulier quand elles encouragent les gens à être responsables des autres et du Bien commun et proposent des vertus et des valeurs qui font vivre la démocratie.
Avec son nouveau chantier sur les rapports entre République laïque et religions, Nicolas Sarkozy a-t-il en tête le reste de l’Europe ? C’est possible. Sur vingt-sept pays européens, vingt-six ne sont pas convaincus par le modèle français. Le mot lui-même est absent dans le dictionnaire de la plupart des langues européennes – ce qui ne veut pas dire que la séparation de l’Église et de l’État et même la laïcité sont absentes dans ces pays, mais que l’interprétation polémique et idéologique qu’on en fait en France est ignorée ou rejetée presque partout.
Mais à chaque pays son histoire et sa tradition. Le constat de rap- ports plus pacifiés dans le reste de l’Europe ne vaut pas argument contre la France, et la laïcité française n’est pas non plus sans avantages – l’Église catholique le reconnaît du reste. Il faut dire aussi que l’Europe politique du ” ni Dieu ni César “, où les religions sont à la fois accueillies favorablement et fortement neutralisées, où précisé- ment la tendance (rationnellement justifiée) est de refuser le ” fait ” du passé et des racines religieuses, n’est pas forcément la solution rêvée pour les rapports entre religion et politique. À son tour l’intégration pacifique et raisonnable si souhaitée aujourd’hui au regard de la violence religieuse, réelle ou fantasmée, gomme sans le dire les aspérités du religieux face au politique, ou encore tout ce qui, du versant plus ” prophétique ” voire ” eschatologique “, n’est pas intégrable dans la démocratie pacifiée et pacificatrice : c’est par exemple l'” interrogation spirituelle ” qu’évoque J. Roman, la critique du poli- tique par le religieux, le ” caractère subversif ” de la mémoire chrétienne, le souvenir ” dangereux ” de la passion du Christ selon le théologien Jean-Baptiste Metz, qui met à mal non seulement des politiques consacrant la victoire des puissants et la défaite des vaincus de l’histoire, mais aussi les Églises ou les religions tranquille- ment alignées sur ces politiques et uniquement soucieuses des bonnes relations avec les responsables de l’État… Ce dernier accorde d’ailleurs très volontiers ses faveurs et ses avantages de toutes sortes aux Églises et aux groupes religieux qui restent dans la sacristie : très vieille histoire !
Laïcité séparatrice ou régime de cultes reconnus, solutions politiques favorables ou défavorables aux religions… : quelle que soit la formule, les questions dérangeantes continuent de se poser aux responsables religieux confrontés au politique, et l’optimisme libéral ne saurait les effacer avec de bons accommodements.