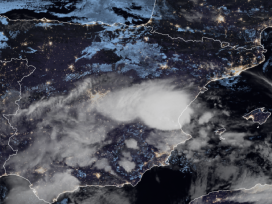La ” mémoire rouge ” revient, comme l’a dit Jorge Semprun, ce qui est bien et de plus inévitable, mais, avec quelques années de retard, et sous une forme réactionnaire, resurgit aussi la ” mémoire bleue “. L’atmosphère devient alors subitement tendue et le lecteur, outre le fait d’être accablé par une foule d’écrits inégaux, parfois répétitifs et ennuyeux, parfois neufs et excellents, se sent de nouveau pris dans une guerre civile, non pas mortifère, mais dangereuse.
L’historien Javier Tusell disait que les perdants espagnols de 1939 avaient ressenti, non pas un lent étouffement personnel face à l’indifférence de la majeure partie de la population comme celui qu’a décrit l’écrivain allemand Victor Klemperer, mais ” une sensation d’étranglement plus immédiate, voire instantanée. Ce ne fut pas tant l’indifférence que la persistance de haines mutuelles et surtout un silence terrible et accablant “.
La mémoire rouge et la mémoire républicaine, qui ne sont pas une seule et même mémoire, traitent essentiellement de la terreur nationaliste et franquiste, de la répression exercée par ” l’autre “. Ceux qui s’identifient aux réprimés sont normalement enclins à l’indignation morale, à la condamnation, non à l’analyse froide et encore moins à la réflexion sur la violence dans leur propre camp et sur leurs responsabilités possibles dans la défaite finale. Ils ne recherchent pas les causes et ne se posent pas la question de savoir pourquoi cela a eu lieu, mais comment. Cette famille de pensée en vient même à utiliser des mots tels ” génocide ” et ” holocauste ” qui ne peuvent s’appliquer à ce qui s’est passé en Espagne entre 1936 et 1939, ni à la terreur franquiste ultérieure. Il faut peser les mots et les utiliser à bon escient. Si l’historien anglais Paul Preston publie l’Holocauste espagnol, c’est son affaire, mais le titre est faux et il commet une erreur conceptuelle, s’il y a lieu de prendre au sérieux le terme employé.
Le gouvernement espagnol a chargé une commission interministérielle d’étudier la situation des victimes de la guerre et de la répression franquiste en vue d’obtenir leur réhabilitation morale et juridique. Carme Molinero, directrice du Centre d’études sur les périodes franquiste et démocratique de l’université autonome de Barcelone, affirme que ” récupérer la mémoire historique pour bâtir la citoyenneté démocratique est un devoir de justice “. Cette thèse est aujourd’hui universellement acceptée dans tous les pays démocratiques. Elle repose notamment sur la thématique des fameux ” lieux de mémoire ” conçue en France il y a une génération, par Pierre Nora et ses collègues. Carme Molinero dit ceci :
La mémoire publique n’est pas spontanée, elle est le résultat d’une sélection de faits qu’il faut garder pour en avoir le souvenir. Il faut décider ce qu’il y a lieu de rappeler et dans quel but. Heureusement, le besoin de réfléchir sur notre passé immédiat s’est répandu dans la société espagnole […], le besoin de retrouver la voix des ” vaincus ” de la guerre civile et des victimes de la répression franquiste.
Elle affirme que le régime franquiste a développé une politique de la mémoire afin de faire disparaître
la mémoire démocratique et de consolider une nouvelle mémoire collective en accord avec ses postulats politiques […].
Elle précise également que
pendant la période de la transition, le développement d’une politique de la mémoire reliée à la tradition démocratique antérieure fut conditionné au souvenir de la guerre civile et à la nécessité d’affermir le régime démocratique. Une fois la démocratie consolidée, les institutions n’eurent pas intérêt à développer une politique de leur propre mémoire, fondée non seulement sur l’exaltation des valeurs démocratiques mais aussi sur les revendications de ceux qui avaient lutté contre le franquisme et qui avaient joué un rôle essentiel dans l’instauration de la démocratie. C’est dire que, pendant longtemps, la fausse mémoire créée par le franquisme ne fut pas contrecarrée institutionnellement par une politique de la mémoire aux références démocratiques passées et présentes.
Carme Molinero remarque que la situation a changé depuis :
La société réclame aujourd’hui de connaître l’ampleur de la répression, veut que l’on cesse de manipuler l’histoire, que les noms des rues et des monuments exercent la fonction didactique qui leur correspond en tant que lieux de mémoire.
Elle conclut :
Finalement les institutions sont en train de tenir compte de cette demande sociale ; cela ne signifie pas confronter des mémoires, mais faire en sorte que la mémoire publique soit établie à partir de la connaissance rigoureuse du passé, ce qui, dans le cas espagnol, suppose de transmettre à la lumière des valeurs démocratiques ce que furent la IIe République, le franquisme et l’anti-franquisme.
Plusieurs auteurs et commentateurs partagent cette thèse. Ils estiment heureux que la démocratie actuelle ait renoué avec la tradition démocratique antérieure, représentée en particulier par la IIe République. Ils insistent sur le fait qu’au moment de la transition et sous le gouvernement socialiste de Felipe González, il y a eu un véritable pacte du silence,
une stratégie de l’oubli, patronnée par les protagonistes politiques de la transition et par des historiens prestigieux […] Le problème n’est pas l’ignorance historique, mais la dérive morale : si on ne règle pas les comptes avec ce passé, les générations à venir assimileront un type d'(in)humanité collective qui garde des germes létaux de toute provenance. Dans le livre de Montsé Armengou et Ricard Belis, les Fosses du silence, il est souligné que la mémoire finit toujours par se manifester, que ce qui n’a pas été fait pendant la transition, n’est pas fait encore maintenant, se fera un jour. Il ne suffit plus de connaître le passé, il faut aussi se demander pourquoi il a fallu se taire.
” Les fosses communes de l’Irak ne diffèrent pas de celles de Franco ” affirme Paul Preston en annonçant que dans son Holocauste espagnol il donnera une ” vision intégrale de la répression pendant la guerre et sous le franquisme “, le franquisme ” régime qui fit tout son possible pour falsifier ce qui s’était passé “. Il dit aussi ” qu’une politique de la mémoire est nécessaire afin de ne pas répéter le passé “.
L’historien Julián Casanova soutient les mêmes thèses dans ses livres et ses articles. ” La mémoire des vainqueurs, maîtres absolus pendant la dictature de Franco, occupe encore une place prééminente si on la compare à celle des vaincus. ” Dès que la question est abordée, surgit ” le syndrome néo-franquiste ” qui consiste à rappeler que la République fut un grave échec qui a conduit à une guerre civile, à un drame, à une tragédie au cours de laquelle tous les combattants commirent des atrocités et à occulter ou à mentionner en passant les assassinats, les tortures et les violations systématiques des droits de l’homme exercées par Franco et par sa dictature. Julián Casanova dénonce ” la convergence entre le révisionnisme historique et ce syndrome néo-franquiste “. Il affirme que pendant la guerre, la répression nationaliste a coûté 90 000 vies et la répression républicaine 55 000, et que si 7 000 ecclésiastiques furent assassinés,
cette violence anticléricale se manifesta parallèlement à la ferveur et à l’enthousiasme des clercs à assassiner dans les lieux gagnés par le soulèvement militaire. La guerre finie, l’Église de la croisade de Franco prit largement sa revanche contre les vaincus.
Dans un autre article, Julián Casanova parle de trois périodes dans l’histoire et la mémoire de la guerre. Pendant les deux premières décennies de la transition, ” un groupe d’historiens divers travailla avec sérieux, mais leurs thèses et leurs conclusions n’atteignirent pas un large public et intéressèrent peu les médias “. Puis vint le temps de la mémoire, à partir de la seconde moitié des années 1990 et pour finir celui de la réaction néo-franquiste suscitée par
certains journalistes connus, propagandistes de droite, férus d’histoire, qui ont repris la vieille ritournelle franquiste selon laquelle la gauche, par sa violence et sa haine, avait provoqué la guerre civile […]. La propagande remplace à nouveau l’analyse historique […] et fonctionne avec les lieux communs habituels sur Octobre 1934, la terreur rouge, l’anticléricalisme, les exécutions de prisonniers politiques de Paracuellos, les Brigades internationales, les prisons républicaines de la Tcheka et l’emprise soviétique.
Ni rouges, ni bleus, plus historiens que mémorialistes
En octobre 2004, un séminaire intitulé ” Mémoires de la guerre et franquisme ” eut lieu à Madrid au cours duquel furent étudiées en toute liberté et sans craindre de rompre avec les discours convenus, différentes approches de la guerre et du franquisme à travers le roman, les autobiographies, les bulletins de nouvelles, les manuels scolaires, le cinéma et les sciences sociales. Il permit de constater qu’on n’avait jamais cessé d’écrire sur la guerre, qu’il n’y a pas eu de temps d’oubli et qu’un poids idéologique pesait très fort en particulier dans les années encore proches du conflit.
Nous avons maintenant une génération qui n’a pas vécu la guerre, ni même la dictature, dit Santos Juliá, et qui par conséquent revient en arrière et voit les faits historiques avec un autre regard.
Paloma Aguilar considère qu’en 1993, à la veille des élections,
les socialistes décidèrent de rompre un des deux pactes non écrits de la transition, qui était de ne pas instrumentaliser la guerre ni la dictature et déclarèrent que la nouvelle droite qui luttait contre eux était la vieille droite de Franco. La voie était ouverte et l’on pouvait à nouveau traiter du passé.
Javier Pradera affirme pour sa part que
ceux qui vers 1956 s’opposèrent à Franco étaient les héritiers de la gauche de la République. Ils se nourrissaient du marxisme et n’avaient rien à voir avec une tradition libérale ni démocratique.
Affirmation qui ne peut que déplaire à Carme Molinero.
Peu auparavant, Javier Tusell déclarait ceci :
Il n’est pas certain que la transition ait suivi une politique d’amnésie volontaire et que ce soit la raison pour laquelle la démocratie n’existe pas complètement. Mais les gouvernements successifs n’ont pas voulu affronter le passé avec rigueur et dans un esprit de réconciliation. Le retour de la ” mémoire rouge ” peut faire oublier que la ” mémoire bleue ” existe aussi. Toute réflexion sur ce qu’a fait un des deux camps doit être accompagnée en parallèle de la réflexion sur ce qu’a fait l’autre camp ou sur ce qu’il aurait fait si l’autre avait été vainqueur. Cela demande de la rigueur. En tenant compte de ces réalités, il sera possible d’avancer dans la réflexion morale […] avec un profond effet cathartique.
Il concluait bravement :
Au risque de ne rien comprendre, le franquisme ne peut se limiter à la répression et nous courons le danger de concentrer sur elle toutes les études scientifiques.
À la même époque, le théologien Olegario González de Cardenal se demandait : ” Qu’en est-il de l’Espagne ? ” Il répondait :
Nous voyons à nouveau cette terrible innocence adamique des Espagnols qui de temps en temps décident d’abolir l’histoire […] Un moment de l’histoire passée est absolutisé ; les autres sont écartés ; une nouvelle législation, une culture, une compréhension de la citoyenneté est mise en place, considérée comme digne et exclusive.
Selon lui, ” cette culture alliée à un pouvoir politique ou utilisée par un pouvoir politique ” mène l’Espagne de l’unité à la pluralité des Espagnes, de la monarchie à la république et chacune de ces étapes a son histoire propre, ses méthodes, son traitement spécifique. Il note
la glorification inconditionnelle et répétée jour après jour de la Seconde République […], comme modèle pur de tout soupçon, en admettant bien sûr que tout a échoué pour des raisons impures, intéressées et violentes.
Il se demande pourquoi
certains groupes culturels n’ont pas fait la moindre révision de leur trajectoire morale et politique, n’ont pas intégré les conséquences de la chute du mur de Berlin […]
et continuent à garder en secret les idéaux des années 1970. Il cite ces phrases de Tierno Galván :
La foi est une aliénation radicale de la vie humaine… Dieu est un jouet cassé. Le mieux qu’on puisse espérer de la cathédrale de la Almudena, c’est qu’elle soit un terrain vague sans la moindre pierre, d’une blancheur immaculée.
La Seconde République pourrait bien être la prochaine pomme de discorde entre les historiens, entre ceux qui travaillent pour l’histoire et ceux qui se mettent au service d’une mémoire. Selon la thèse ” bleue “, ” les insurgés ” de juillet 1936 n’ont pas fait un coup d’État et ne furent pas des ” insurgés ” car les socialistes en octobre 1934, dans les Asturies, avaient pris les armes contre la République. La thèse de l’autre camp se limite à nier toute relation entre cette insurrection et le début de la guerre civile. C’est connu. La récente historiographie ” révisionniste ” ou ” néo-franquiste ” insiste sur le fait qu’Octobre 1934 est le moment de la faillite définitive des institutions républicaines et qu’il faut considérer cette date comme le point de départ de la guerre civile. ” Cette opinion de pamphlétaires, nouveaux convertis, est partagée pour l’essentiel par des historiens plus professionnels ” reconnaît l’historienne Marta Bizcarrondo. Pour sa part elle réfute cette interprétation et pense que ” l’insurrection préventive ” du Parti socialiste espagnol (Psoe) et de l’Union générale des travailleurs (Ugt) s’explique par les antécédents en Allemagne en 1933 et en Autriche en 1934, par les triomphes du fascisme en Europe et la stratégie ” suicidaire ” de la social-démocratie. Et de comparer le dirigeant de la Confédération espagnole des droites autonomes (Ceda), José María Gil-Robles, au chancelier Dollfuss. Certes, elle reconnaît la radicalisation socialiste dès le milieu de l’année 1933, fondée sur une
interprétation primaire d’une politique socialiste en démocratie, avec une propension suicidaire à répondre par une insurrection à un éventuel tournant politique à droite [à l’occasion de l’entrée au gouvernement de trois ministres de la Ceda].
Elle estime que pour les socialistes,
de façon surprenante, la démocratie en tant que telle n’entrait pas encore dans leur stratégie […]. L’insurrection de 1934 a certainement aiguisé les tensions qui ont précipité la crise du régime ; a posteriori on peut dire qu’elle n’a fait aucun bien à la démocratie républicaine, au contraire. Ceci dit, rien n’indique que les généraux seraient restés dans leurs casernes face à une nouvelle victoire électorale de la gauche…
L’historien Juan Francisco Fuentes pense pour de multiples raisons qu’il est possible d’établir une ligne de continuité entre octobre 1934 et juillet 1936. Il faut aussi mentionner l’usage rhétorique du concept de guerre civile pratiqué depuis un moment par la gauche du Psoe : ” Nous sommes en pleine guerre civile ” avait affirmé Caballero à la fin de l’année 1933 et dans quelques textes révolutionnaires d’octobre 1934. De même Santos Juliá signale la spirale révolutionnaire qui a conduit à la grève générale d’octobre 1934. Dans son livre Et Madrid ? Que fait Madrid ? Mouvement révolutionnaire et action collective 1933-1936, Sandra Souto étudie ce processus de radicalisation de la gauche ouvrière espagnole à partir de 1933 dans le cadre de la violence sociale et politique de l’époque. Elle explique pourquoi une telle violence a échoué, alors que le mouvement avait été minutieusement préparé par les dirigeants de la gauche, avec armes, préparation militaire et formation d’un shadow government, donc comme un ” Octobre ” de style bolchevique avec soulèvement armé de milices socialistes et de militaires professionnels sympathisants. Pour Fuentes, ” Octobre 34 ” marqua ” la dérive de l’Espagne républicaine vers une guerre civile que certains leaders politiques considéraient depuis longtemps comme non seulement inévitable, mais même souhaitable “.
Bartolomé Bennassar, grand historien français aux multiples facettes, vient de publier la Guerre d’Espagne et ses lendemains. Comme beaucoup d’historiens il souligne l’importance d’Octobre 34 ” devenu le prélude de la guerre civile en déchaînant un processus révolutionnaire qu’il ne sera plus possible de contrôler “. Selon lui, l’échec du réformisme républicain est lié à l’absence d’une réforme agraire sérieuse comme celle que Lázaro Cárdenas terminait au Mexique dans les années 1930. Le processus révolutionnaire qui démarre après la courte victoire du Front populaire (de 200 000 voix) arrive très tard pour résoudre ce problème et contribue à entraîner la guerre. Bennassar repousse la version d’un petit groupe de conspirateurs militaires et cléricaux qui font un coup d’État pour des motifs égoïstes et préfère considérer ” juillet 1936 comme un processus interactif complexe auquel tous participèrent, gauches et droites “.
De nombreux historiens, tels Bartolomé Bennassar, Antonio Cazorla, J. F. Fuentes, Santos Juliá, Enrique Moradiellos, considèrent qu’il faut parler de la guerre civile en évitant tout caractère passionnel. ” J’ai voulu décanter 30 ans de recherche historique avec un regard serein ” dit Moradiellos dans la présentation de son livre 1936. Les mythes de la guerre civile. Il met en question deux versions, deux tendances :
Celle qui raconte la guerre comme un mythe épique, une geste héroïque et reproduit les positions que chaque camp a défendues dans les tranchées ; l’autre remplace le caractère épique par une vision douloureuse et voit la guerre comme une tuerie fratricide, une folie tragique dans laquelle tous se trouvèrent impliqués. Cette interprétation prépare la transition : étant donné que la guerre a été une folie, il s’agit de préparer le pardon et l’oubli.
L’historien présente un tableau plus complexe que le mémorialiste.
Moradiellos voit s’affronter avant que n’éclate la guerre, la révolution, la réaction et la réforme sans qu’aucune de ces formes ne parvienne à s’imposer clairement.
Si la guerre a éclaté, ce fut parce qu’il existait dans ces années-là la conviction généralisée que la violence était un chemin efficace pour chaque tendance d’arriver à ses fins et parce qu’une de ces tendances avait accès aux armes. L’armée, au lieu de défendre le gouvernement légitime, se fractura, se divisa en deux.
Antonio Cazorla affirme quant à lui :
Il est indéniable que la plupart des historiens universitaires sont plus à gauche que la majeure partie de la société, ce que reflète sans doute leur travail. Qui plus est, il y a encore dans l’¦uvre de certains historiens un vieux point de vue ” front populiste ” qui tente de gagner des batailles qui n’ont plus lieu d’être. Nous devrions tous avoir assumé beaucoup de choses peu agréables à propos de la République encore idéalisée ; nous devrions mettre davantage l’accent sur les crimes commis en son nom, en reconnaissant la légitimité de la souffrance du prochain, sans tenir compte du motif pour lequel il fut tué et par qui.
En ce qui concerne la répression, les historiens ont été capables, à la différence des mémorialistes qui ne comptabilisent que leurs morts, de l’aborder ” sans complaisance ni pour les vainqueurs, ni pour les vaincus ” selon Bartolomé Bennassar. Il souligne par ailleurs que les deux camps n’ont cessé au cours de la guerre
de se comporter comme des agences de désinformation et des usines à rumeurs et à mensonges, avec une constance sans faille et une parfaite mauvaise foi.
Il accepte avec prudence les conclusions du livre coordonné par Santos Juliá, Victimes de la guerre civile, les chiffres de plus de 120 000 victimes pour les deux répressions et il conclut que pendant la guerre
la violence assassine de la révolution égala celle de la réaction, ce qui est logique, car, au moins jusqu’à la fin de 1936, l’Espagne du Front populaire était plus peuplée.
Le livre se termine par des réflexions sur la mémoire de la guerre civile aujourd’hui. Il approuve la création de ” l’Association pour la récupération de la mémoire historique “, pourvu que cette ” récupération soit totale, différenciée, précise et dirigée avec méthode et rigueur “. Tâche difficile. Il rejette le livre les Fosses de Franco de Silva et Santiago Macías, le qualifiant de confus et exagéré, de ” modèle à ne pas imiter “, de même que les Fosses du silence de Armengou y Belis.
Le silence sur la répression républicaine est en train de disparaître, sans être toujours le fait du néofranquisme : François Godicheau a fait sa thèse de doctorat sur la Catalogne, la Guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne. Il révise l’histoire du courant anarchiste, cette guerre civile dans la guerre civile vécue par la Catalogne, ” le processus inavouable de mise au pas et presque de bolchevisation ” de la Confédération nationale du travail (Cnt), la répression implacable dans un État républicain moribond.
Jorge M. Reverte, dans son livre la Bataille de Madrid, raconte comment certains républicains pratiquèrent une politique d’extermination de l’adversaire, ” une routine de la mort ” qu’il décrit en détail avec documents à l’appui. Il démontre que les ” rafles ” de prisonniers, les ” promenades ” ne furent pas une pratique incontrôlée et incontrôlable, comme l’ont parfois affirmé les défenseurs de la mémoire républicaine. Il cite un accord entre le Comité national de la Cnt et le Conseil de l’ordre public de la junte de défense concernant ” l’exécution immédiate, en toute responsabilité, de fascistes et d’éléments dangereux “. ” J’ai voulu étudier, dit Reverte, quelques questions qui ne paraissent pas claires, comme le désir des anarchistes d’avoir l’hégémonie militaire ou la répression organisée à Paracuellos. ” C’est l’unique façon de désarmer le ” révisionnisme néo-franquiste ” d’un Pío Moa.
C’est ce que fait Ignacio Martinez de Pisón dans son livre Enterrer les morts, qui traite de l’assassinat de José Robles, traducteur de John Dos Passos et victime républicaine des communistes. Dos Passos abandonna le tournage du documentaire ” Terre espagnole ” parce qu’on lui demandait de passer sous silence les assassinats dont il avait connaissance. Il n’accepta pas comme valeur suprême les purges du Parti communiste et des commissaires soviétiques au nom de la défense de la République. Cette peinture de la morale totalitaire de gauche fera grincer des dents ; il existe encore des gens pour considérer George Orwell comme un fasciste.
Pío Moa et l’historiographie néofranquiste Pío Moa, Los Mitos de la guerra civil [Les mythes de la guerre civile], Madrid, La Esfera de los Libros, 2003 ; Contra la Mentira, Madrid, Libros Libres, 2003 ; Crimines de la guerra civil y otras polemicas, La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.
Pío Moa est un auteur à succès prolifique. La lecture de son livre les Mythes de la guerre civile, qui a dépassé les 100 000 exemplaires en six mois, suffit à comprendre le phénomène, l’inévitable retour de manivelle, prévisible après tant de témoignages de la ” mémoire rouge “. Moa incarne la ” mémoire bleue “. Il accuse les historiens d’être les complices d’une fausse mémoire rouge, les fabricants ou les notaires des ” mythes ” rouges. Il dénonce une prétendue incompétence professionnelle, empoisonnée par le ressentiment des vaincus qui calomnient les vainqueurs. Il se dit démocrate et présente le général Franco comme l’homme qui sauva l’Espagne du totalitarisme, non seulement du totalitarisme de Staline, mais aussi de celui d’Hitler, avant de la mener vers la modernisation et… la démocratie. À juste titre, Antonio Cazorla proteste :
Moa a remis en question et même insulté le travail des historiens professionnels en les accusant d’être partiaux […] Il est certain que la critique de la production académique, si on ne se laisse pas aller à l’insulte facile, est en partie fondée.
Pío Moa, au terme d’un long itinéraire politique qui le mena de la gauche armée (Grapo) à la droite espagnole contemporaine, a essayé de provoquer une sorte d’équivalent espagnol de la fameuse Historikerstreit allemande. Malheureusement, il n’est pas Ernst Nolte, mais seulement un habile récupérateur de la vieille historiographie franquiste et de ses mythes qu’il recycle avec succès en librairie. La première édition de son gros volume suit de peu l’ouverture des premières fosses communes de la répression franquiste, ouverture qui venait après une avalanche de livres sur la ” mémoire rouge “. Ce livre fut une réponse plutôt efficace de la droite et de la ” mémoire bleue ” et atteignit un public qui alla bien au-delà de l’électorat du Parti populaire. Il semble que les jeunes, fatigués de l’enseignement de l’histoire scolaire tel qu’il leur est donné, se soient précipités sur le livre de Moa.
Les historiens académiques ont tardé à répondre au provocateur, surtout parce qu’il leur semblait absurde de batailler avec un détestable ” amateur ” qui n’apportait rien de nouveau. Ils se rendirent compte par la suite que le succès de Moa pouvait répondre à une demande sociale et qu’il n’était pas possible de le laisser agir en pleine liberté. Inévitablement le débat prit vite une coloration politique. Stanley Payne, historien américain et spécialiste de l’Espagne contemporaine, prit sa défense dans la Revista de los Libros ou, mieux, dénonça la dictature du ” politiquement correct ” dans l’historiographie espagnole, dans une Espagne incapable d’examiner librement et sereinement son passé, étant donné que les perdants ” gagnèrent en grande partie la bataille de la propagande “. Au nom de l’esprit critique, Payne nous invite à nous libérer d’une lecture idéologique de l’histoire ” plus digne de l’Italie fasciste ou de l’Union soviétique que de l’Espagne démocratique ” (sic). De telles contributions ne font progresser ni le débat de fond, ni la connaissance.
Javier Tusell fit alors observer que l’entreprise de Moa contredisait la résolution du Congrès sur le ” coup d’État ” de 1936, résolution approuvée en 2002 par tous les partis, après des années de discussion. Le travail de Moa serait une ” offense à l’esprit de la transition et de la réconciliation “. Ce à quoi Moa répliqua tranquillement que la ” mémoire rouge ” offensait aussi l’esprit et qu’il ne faisait que rendre le coup. À juste titre, Tusell répondit ” qu’il est abracadabrant d’utiliser ce type d’argumentation historique pour la bataille politique d’aujourd’hui. Si on l’utilise, le vivre ensemble devient impossible “.
Qu’en est-il ? Les deux Espagnes partiraient-elles en guerre de nouveau l’une contre l’autre ? Et où est la troisième Espagne ? Quelqu’un a dit qu’il y avait en fait trois Espagnes, celles des deux camps en lice avec leurs convictions, leur fanatisme et celle des 80 % de la population restante, celle qui était prise dans la guerre et n’aspirait qu’à survivre. Dans ses Mémoires, Pío Baroja note que le curé Ariztimundo, nationaliste convaincu, au moment d’être fusillé, bénit le peloton qui l’exécuta.
Quelle crédulité extraordinaire ! Il est dommage que des hommes intelligents et honnêtes puissent avoir une telle foi, digne d’un hottentot ou d’un nègre.
Une autre fois il écrit :
Ils ont fusillé le médecin d’un petit village voisin, un nationaliste basque exalté qui s’est refusé catégoriquement à crier Vive l’Espagne ! Quel absurde fanatisme ! Qu’importe que restent en suspens dans l’air : Vive l’Espagne ! ou vive Franco ! ou vive la Pepa !
Pío Baroja appartenait-il à cette troisième Espagne ?
Et où situer Salvador de Madariaga ? Javier Tusell lui a rendu un bel hommage posthume :
Il n’a jamais fait partie de l’un ou l’autre camp en guerre ; de plus il a tenté de promouvoir la paix par le seul procédé réellement viable, la médiation des puissances démocratiques. Double lucidité par conséquent que la sienne : celle des principes et celle des instruments.
Devrions-nous, nous les historiens, suivre l’exemple de don Salvador et ne pas nous enterrer dans l’une des deux tranchées comme combattant ou brancardier de la nouvelle guerre des mémoires ?
Bibliographie
Montsé Armengou et Ricard Belis, les Fosses du silence, Barcelone, Plaza y Janés, 2004.
Juan Avilés Farré, La foi qui vint de Russie. La révolution bolchevique et les Espagnols, 1917-1931, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.
Bartolomé Bennassar, la Guerre d’Espagne et ses lendemains, Paris, Perrin, 2004.
Gabriel Cardona et Juan Carlos Losada, Même si tu me jettes du pont, Madrid, Aguilar, 2004.
Julián Casanova, l’Église de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2002.
Antonio Cazorla Sánchez, les Politiques de la victoire. La consolidation du nouvel État franquiste, 1938-1953, Madrid, Marcial Pons, 2000.
Francisco Espinosa Maestre, la Justice de Queipo. Violence sélective et terreur fasciste dans la IIe Division en 1936, Séville, éd. à compte d’auteur, 2000.
François Godicheau, la Guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne, Paris, Odile Jacob, 2004.
Santos Juliá (sous la dir. de), Violence politique dans l’Espagne du xxe siècle, Madrid, Taurus, 2000.
Santos Juliá, Histoire des deux Espagnes, Madrid, Taurus, 2004.
Conxita Mir, Vivre, c’est survivre. Justice, ordre et marginalisation dans la Catalogne rurale de l’après-guerre, Lleida, Milenio, 2000.
Pío Moa, les Mythes de la guerre civile, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003.
Enrique Moradiellos, l’Espagne de Franco (1939-1975), Madrid, Síntesis, 2000.
Enrique Moradiellos, 1936. Les mythes de la guerre civile, Barcelone, Península, 2004.
Mirta Núñez Díaz Balart, les Années de la terreur. La stratégie de domination et de répression du général Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.
Stanley Payne, le Collapsus de la République. Les origines de la guerre civile, 1933-1936, Madrid, la Esfera de los Libros, 2005.
Jorge M. Reverte, la Bataille de l’Ebre, Barcelone, Crítica, 2003.
Jorge M. Reverte, la Bataille de Madrid, Barcelone, Crítica, 2004.
Francisco Sevillano Calero, Extermination. La terreur de Franco, Oberón, 2004.