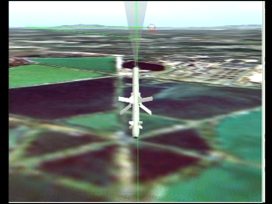L'art de ne s'habituer à rien
Le travail précaire au temps du capitalisme flexible
Lorsqu’au printemps 2006, en France, on assista à des grèves et à des manifestations de masse contre le projet visant à assouplir la protection de licenciement, un parallèle avec mai 1968 a pu se dessiner pendant quelques temps. Mais, contrairement à l’ambiance de renouveau de la révolution culturelle de cette époque, il n’était pas question de créer une nouvelle société, mais plutôt de maintenir le système social existant avec ses garanties et ses mécanismes de protection. Le partenariat social pratiqué pendant des décennies entre le capital et le travail a également été de plus en plus fragilisé en Allemagne et en Autriche, avec le renforcement du néolibéralisme. Le modèle du travail salarié habituel et des systèmes d’assurances qui y sont liés sont en train de disparaître. Dans la perception publique, ce développement est également assimilé à une perte de pouvoir de l’Etat social.
La société fragmentée du travail
L’extension des systèmes d’assurance sociale a donné naissance au XX siècle à un Etat-providence à multiples facettes qui n’a pas crée de société des égaux mais une “société des semblables” (R. Castel). Elle reposait comme auparavant sur des hiérarchies de classe, toutefois sur la base de droits et ressources communes. L’état social interventionniste était donc là, non pas pour la justice dans la répartition, mais pour les droits de protection sociale. Avec l’instauration définitive du fordisme, la relation normale de travail salarié a pu se généraliser de façon telle que la majorité des travailleurs a pu participer à une consommation croissante et à une construction des services publics. D’une existence prolétaire stigmatisée avec ses conditions de vie misérables, on est arrivé à une position sociale “respectable”. Le progrès dans l’extension des protections sociales a permis d’englober également des groupes qui ne se trouvaient pas directement dans des relations de travail salarié. L’Etat social était devenu l’Etat-providence.
Dans les années 70, le modèle de croissance fordiste a connu une double crise. D’un côté le mode de production tayloriste arrivait aux limites dans les profits qu’on pouvait en tirer, et de l’autre, on assistait à un échec des instruments de l’Etat-providence national compte tenu de l’internationalisation croissante de l’économie. De nombreux gouvernements occidentaux ont commencé à se tourner vers des concepts néo-libéraux et suivre un nouveau cours : diminution des interventions de l’Etat et des subventions, au profit de la concurrence, de la baisse des impôts et réduction des dépenses sociales.
Toutefois, les pratiques quotidiennes des individus ont aussi contribué de façon décisive à faire vaciller les modèles de sociabilité. L’orientation croissante des masses vers la consommation a sapé l’éthique exigée du travail et l’hédonisme grandissant de la jeunesse s’est orienté contre les disciplines rigides qui dominaient alors à l’école, à l’usine et au sein de la famille. Il en a résulté une série de mouvements sociaux qui attaquaient les structures autoritaires et hiérarchiques et revendiquaient “l’autonomie” et l’accomplissement de soi. L’intensité des luttes et la libération de la “subjectivité autonome” ont toutefois conduit, non à la destruction du mode de production capitaliste, mais davantage à une régénération du capitalisme.
C’est ainsi que le projet néolibéral a repris la critique des états sociaux autoritaires et l’a appliquée en même temps contre les sujets. Les nouvelles technologies du pouvoir ont pour objectif d’individualiser les risques sociaux et de réduire les anciennes protections sociales. Le néolibéralisme a réagi aux aspirations vers l’autonomie et à la recherche d’espaces de structuration individuels avec l’ordre intimé aux individus de “s’activer”. Ce n’est plus l’Etat mais les citoyens qui doivent se protéger et se responsabiliser face à la pauvreté, au chômage et à la maladie. Il en résulte ainsi une nouvelle domination et un nouveau mode de production qui – contrairement à la régulation fordiste du social – repose sur une institutionnalisation de l’insécurité. En son c¦ur, on retrouve un renforcement des mécanismes de régulation façonnés par le marché, aussi bien dans les institutions publiques que dans les entreprises.
Au niveau des entreprises, les modes de production et la politique du personnel sont de plus en plus définis en fonction des attentes de rendement à court terme des investisseurs institutionnels et des marchés financiers. Pour atteindre les objectifs élevés de rentabilité, le management mise avant tout sur la flexibilité : au niveau externe par la délocalisation d’unités entières des entreprises (“outsourcing”, “offshoring”), et au niveau interne par la formation de ces “business Units” (conduite au-delà des marges de gain, facturations internes etc.). Les mécanismes de contrôle et de direction sont de plus en plus assurés par les contraintes du marché, et remplacent la surveillance directe et la domination personnifiée. De cette façon, l’importance du facteur travail, autrefois concentré dans les entreprises, se trouve aujourd’hui systématiquement réduite. Alors que les concepts de production flexible avaient mené à une division entre “noyau dur” et “travailleurs à la marge”, c’est-à-dire entre le personnel permanent et les simples travailleurs (extension du travail intérimaire, augmentation des contrats de travail à durée déterminée), on assiste depuis les années 90 à une “fluidification” de l’ancien noyau. Ces mesures de rationalisation aboutissent à exposer complètement la force de travail aux risques du marché. Effectivement, des activités atypiques et précaires sont de plus en plus nombreuses dans toutes les branches et groupes professionnels. Actuellement, en Allemagne, parmi les salariés, environ 13 millions sont employés avec des contrats de travail précaires.1
Selon le sociologue français Robert Castel,2 la société du travail post-fordiste est cloisonnée en plusieurs segments. A côté de la “zone d’intégration”, avec les contrats de travail classiques, protégés, il existe une “zone de désaffiliation”, qui comprend tous les hommes qui sont complètement exclus du travail rémunéré. Une “zone de vulnérabilité” grandit entre ces deux zones, dans laquelle se constitue l’armée de réserve géante des précaires, avec les stagiaires éternels, les extras payés selon le service ou le temps passé, ceux qui travaillent pour un ou deux euros et les pseudo-indépendants.
Le sociologue du travail Klaus Dörre a étudié en détail le phénomène de la précarité.3 Selon lui, les précaires se trouvent dans une “situation de flottement” étrange : d’un côté, selon le modèle néolibéral de la “responsabilité personnelle”, ils doivent accepter n’importe quel travail mal payé, et de l’autre, on leur fait comprendre qu’ils doivent investir beaucoup d’énergie et de temps dans leur formation continue pour échapper à une pauvreté menaçante. Cependant, l’orientation selon les occasions et l’investissement planifié s’excluent mutuellement. Comment les personnes concernées peuvent-elles poursuivre des buts à long terme si elles doivent constamment réorganiser leur vie et se réorienter ?
L’existence des précaires crée également, d’après Dörre, une “zone de vulnérabilité”. Contrairement aux chômeurs de longue durée, beaucoup de précaires travaillent près du personnel permanent. Les “intégrés” ont toujours la réalité du travail des intérimaires ou des indépendants sous les yeux. Ils voient donc leurs propres remplaçants potentiels. Le travail à plein temps avec sécurité de l’emploi devient ainsi un privilège menacé.
L’extension de la “zone précaire” signifie-t-elle aussi un déclassement des couches moyennes ? Jusqu’à présent, ce sont surtout les milieux ouvriers qui ont été touchés par les concepts de production flexible ainsi que par la désindustrialisation qui les accompagnent. Alors que le fordisme avait mené à une “déprolétarisation” des travailleurs non qualifiés et qualifiés, ceux-ci sont à présent socialement dégradés. Les emplois qui restent dans l’industrie sont caractérisés par une grande précarité, tout comme les nouveaux postes dans le domaine des services (“working poor”). Conformément à cela, environ trois quarts des pauvres en Allemagne viennent de ces groupes. Le discours sur la démarginalisation de la pauvreté est donc trompeur. La “zone d’insécurité” s’étend en effet aux classes moyennes, mais les migrants et les ménages d’ouvriers sont toujours les plus fortement touchés par la précarité.4
Freelance
La dérégulation du travail a aussi amené un nouveau type “d’actifs autonomes”. Il s’agit d’un groupe hétérogène qui va du chauffeur de camion formellement indépendant d’une entreprise de transports à l’informaticien payé au contrat, en passant par l’entrepreneur sous franchise d’une société de gastronomie rapide. Une tendance apparaît dans tous ces types de contrat de travail visant à faire disparaître le caractère salarié du travail en transférant les risques sociaux vers les “nouveaux indépendants”.
On peut principalement séparer les “freelances” en deux catégories. D’un côté il y a les indépendants du domaine des technologies de l’information et de la communication, qui disposent de hauts revenus et de nombreuses gratifications. Ils sont largement libérés du souci de devoir travailler durablement à leur reproduction. De l’autre, il y a les indépendants et les professionnels à leur compte qui gagnent peu et qui, à cause de leurs faibles revenus et de leurs emplois discontinus ne disposent à peine d’économies. En Allemagne, ce groupe qui comporte aussi les EURL (entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, “Ich-AG” en allemand) compte aujourd’hui plus de 4,5 millions de personnes.
Le sociologue Sergio Bologna a dressé un portrait différencié des “actifs autonomes” à partir d’études de plusieurs années : les freelances sont eux-mêmes responsables de l’organisation et du déroulement de leur travail, leurs activités sont de ce fait plus diversifiées et comportent le travail spécialisé et la comptabilité aussi bien que la communication. L’auto-management amène une série de conséquences avec lui : premièrement un auto-contrôle renforcé du travail, c’est-à-dire plus de responsabilité, également décidée selon des structures formelles par autrui ; deuxièmement, une utilisation économique élargie de soi, c’est-à-dire un marketing stratégique de ses propres capacités humaines ; troisièmement, une auto-rationalisation, ce qui signifie que la façon qu’on a de conduire sa vie efface presque la distinction entre travail et loisir.
Les travailleurs indépendants doivent organiser et entretenir leurs relations avec le monde extérieur de façon autonome. Bien que ce “travail relationnel” (S. Bologna) constitue une partie centrale de leur activité, il est non seulement invisible pour le client mais aussi non payé. Pour assurer sa propre reproduction, il convient de rester en contact, de se tenir informé des contrats ou emplois et d’être à nouveau recommandé. C’est pourquoi, les freelances considèrent aussi toujours leurs connaissances et amis sous l’angle du networking, les relations amicales et les intérêts étant toujours mêlés. Le fait qu’il soit impossible de prévoir les nouveaux contrats contraint les travailleurs indépendants à laisser ouvertes différentes options. A cet effet, les compétences, les contacts et les énergies doivent être mobilisés sans pour autant être sûr que ces investissements seront rentables un jour. Le temps de travail du freelance est irrégulier, puisque sa rétribution n’est pas mesurée en fonctions d’une unité de temps élémentaire mais finalement selon le résultat. L’effet est une intensification de la journée de travail.
L’insécurité permanente exige des personnes concernées une mobilité constante et une grande volonté personnelle pour s’adapter aux nouvelles tâches et aux nouvelles règles. Le théoricien post-opéraïste Paolo Virno a caractérisé5 l’art du louvoiement comme un “opportunisme”, sans l’identifier à une valeur morale. L’opportuniste serait celui qui, confronté à un ensemble de possibilités se modifiant sans cesse, serait préparé à faire face à une grande partie de ces possibilités, de façon à ce qu’il puisse saisir rapidement la prochaine occasion qui se présente. En même temps, l’activité du travailleur indépendant prend place dans un réseau dense de relations hiérarchiques et repose sur une relation personnelle de dépendance aux fournisseurs de contrat et clients. Ainsi, le “travail autonome” suppose aussi des “traits de servilité”.
Les créatifs précaires
L’ancienne Sénatrice berlinoise à la culture, Adrienne Goehler constate dans son livre “Verflüssigung”,6 que la majorité de la population n’est pas encore préparée à la disparition du travail salarié traditionnel. A l’inverse, la plupart des artistes se seraient déjà habitués à des situations de travail précaires. Ils ont donc constitué “l’avant-garde” d’un développement auquel les modes de vie et de travail de toute la société devront bientôt s’adapter. En fait, le travail en freelance et d’autres formes d’activité flexibles et précaires (comme les stages) sont devenus la règle dans le domaine culturel, et la politique restrictive d’austérité du secteur public n’y est pas pour rien. Quelques chiffres concernant l’Allemagne peuvent illustrer ceci : dans les années 80, il y avait encore plus de 80% de musiciens salariés, alors que vingt ans plus tard, ce pourcentage était descendu à 54%. Dans le domaine des arts de la scène, sur la même période, le taux de salariés est passé de 76 à 58%. En même temps, le nombre de personnes travaillant dans le domaine culturel a augmenté au total dans les dix dernières années de plus de 30%. Les travailleurs indépendants du domaine culturel ont représenté la part la plus importante de cette dynamique. Leur nombre a augmenté quatre fois plus rapidement que celui du groupe, en général, de tous les indépendants de la population active.7
D’après les données de la caisse d’assurance sociale des artistes, le revenu annuel moyen des assurés masculins était en 2003 de 12 489 euros et celui des assurées féminines de seulement 9 359 euros. Pour la plupart des chercheurs travaillant sur la pauvreté, on entre dans la zone de précarité à 60% du revenu moyen. En 2003, cette limite correspondait en Allemagne à 983 euros par mois. De même, une étude actuelle du Conseil culturel allemand (confédération des associations culturelles) indique que presque deux tiers des 318 000 actifs indépendants, soit environ 50% des actifs dans le domaine des entreprises culturelles, réalisent un chiffre d’affaire annuel de moins de 17 000 euros. Pour pouvoir survivre en tant qu’artiste, beaucoup de créatifs sont contraints d’exercer un travail qui n’a aucun rapport avec leur profession.
D’une certaine façon, l’industrie culturelle est devenue un laboratoire pour expérimenter la dépréciation de la force de travail en tant que bien marchand. Pour la majorité des travailleurs du domaine culturel, des normes comme la productivité ou la flexibilité – qu’ils condamnent souvent eux-mêmes comme endoctrinement capitaliste – sont devenues une deuxième nature. Ils représentent ainsi l’avant-garde du post-fordisme pour lequel ils posent sans cesse les nouveaux jalons de l’auto-exploitation. Les valeurs d’autonomie, d’accomplissement de soi mais également de sentiment, d’expérience et de créativité, autrefois mobilisées contre la réification capitaliste, sont devenues une importante ressource pour un processus de mise en valeur économique. Cependant, alors qu’aujourd’hui dans la littérature managériale on professe que le non-conformisme est la clef de la réussite professionnelle – comme une façon de rendre glamour cette obéissance due aux impératifs de la flexibilité – le groupe de rock Britta se demande face à leurs conditions de vie de plus en plus précaires s’ils appartiennent encore à la “bohème” ou au “prolétariat”.
Après le travail salarié
Ces dernières décennies ont vu l’éclatement des ressources de la solidarité collective créées par les sociétés industrielles issues par l’expérience commune d’un travail aliénant. Actuellement, face à une flexibilité et une dérégulation accrues, de nombreux critiques du projet néolibéral succombent malgré tout à la nostalgie de l’âge d’or du fordisme. Cependant, les bases sociales et économiques de ce système n’existent plus. Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille renoncer à la lutte en vue d’améliorer les standards sociaux et laisser les néolibéraux recycler les débris de l’état providence. Mais à cette précarisation généralisée du travail répond une multitude de divisions et de hiérarchies sociales. Un énorme fossé sépare le travailleur du domaine culturel détenteur d’un passeport allemand d’une immigrée clandestine. De plus, les nouvelles formes de travail ont entraîné une telle modification de la vie quotidienne que les freelances surtout n’arrivent plus à imposer leurs exigences d’une vie meilleure par les voies traditionnelles de la revendication salariale. Comment organiser syndicalement des hommes dont la vie professionnelle se passe entre leurs quatre murs ? Comment organiser un grève et contre qui ? La question d’une action collective contre la flexibilité imposée par un capitalisme arrogant se pose aujourd’hui d’une façon tout à fait nouvelle.
Karl Heinz Roth, Der Zustand der Welt, Hamburg 2005.
Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, Paris: Gallimard 1999.
Klaus Dörre, "Entsicherte Arbeitsgesellschaft. Politik der Entprekarisierung", in: Widerspruch 49/ 2005, 5-18.
Olaf Groh-Samberg, "Die Aktualität der sozialen Frage", in: WSI-Mitteilungen 11/2005.
Paolo Virno, A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life, Nork York: Semiotext[e] 2005.
Adrienne Goehler, Verflüssigungen. Wege und Umwege vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft, Frankfurt/New York 2006.
Veronika Mirschel, "In der Sahelzone der Einkommen. Zur sozialen Lage von KünstlerInnen und freien Medienschaffenden", in: Forum Wissenschaft, 3/2005, 23-26.
Published 6 March 2007
Original in German
Translated by
Caroline Segal
First published by Springerin 3/2006 (German version)
Contributed by Springerin © Klaus Ronneberger / Springerin / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.